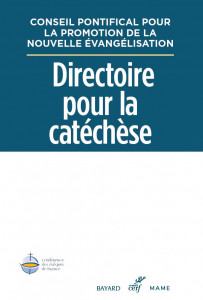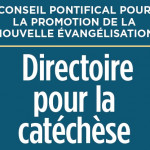Relire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu
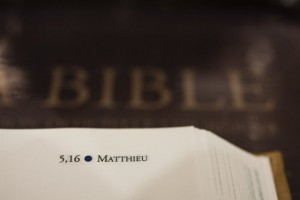 L’expérience de confronter sa propre histoire ou l’histoire de sa famille à des récits bibliques semble souvent une aventure impossible. Le contexte de la Bible semble tellement éloigné du contexte moderne que les ponts ne paraissent pas vraiment possibles.
L’expérience de confronter sa propre histoire ou l’histoire de sa famille à des récits bibliques semble souvent une aventure impossible. Le contexte de la Bible semble tellement éloigné du contexte moderne que les ponts ne paraissent pas vraiment possibles.
La Commission biblique pontificale a écrit un texte intitulé Bible et morale pour permettre de savoir à quelles conditions les textes bibliques sont pertinents pour éclairer nos situations contemporaines. Il n’y a pas de lien immédiat. Pour savoir ce que Dieu attend de nous aujourd’hui, il faut faire un véritable travail d’interprétation. Ce texte établit des critères.
Environ 80% de la Bible consiste en des récits. Les récits bibliques ont été mis en œuvre, de façon longue et patiente, de manière à être disponibles dans un contexte qui n’est pas celui dans lequel les personnages évoluent. Par exemple, les récits sur Abraham ne correspondent en rien à l’époque où Abraham a vécu. Ils ont été écrits plus de 1000 ou 1500 ans plus tard et ils sont déconnectés du contexte initial dans lequel il a pu vivre et qui nous échappe en grande partie. La vérité du récit d’Abraham n’est pas faite d’abord pour rejoindre le contexte dans lequel il a vécu mais pour rejoindre le contexte de son lecteur. Les récits de l’Ancien comme du Nouveau Testament ne collent pas directement aux événements pour être recevables dans un contexte différent. Le récit biblique prend en compte déjà ce nouveau contexte. Il est beaucoup plus proche de notre monde que nous ne le croyons.
Pourquoi raconte-t-on de cette manière-là ?
Le théologien français Bernard Sesboüé a traité, il a vingt-cinq ans, des récits du salut. Cela reste d’une extraordinaire pertinence et cela montre la vigueur et la vitalité du récit biblique, en particulier sur deux interrogations qu’on est en droit de poser: une question d’identification personnelle (nécessité de se comparer à d’autres personnages pour se situer) et le besoin de se projeter (où vais-je ? de quoi suis-je capable ?). Raconter une histoire, pour soi ou à quelqu’un d’autre, c’est rencontrer et commencer à répondre à ces questions.
Comment fonctionne un récit ?
Il est bon d’identifier un certain nombre d’ingrédients présents dans le récit. Pour cela, il faut s’intéresser à une discipline relativement nouvelle dans le domaine biblique, la narratologie. Cette discipline est née aux États-Unis dans les années 80, est arrivée en Europe dans les années 90 et à Paris en l’an 2000. On découvre que les récits ont de manière intrinsèque une véritable vertu. C’est une découverte à destination de tous et en particulier de la catéchèse. On choisit son personnage, héros ou anti-héros ; on choisit son cadre, réaliste ou fantastique.
Les récits bibliques ont des caractéristiques que l’on peut tourner en avantage.
Tout d’abord, les récits sont à peu près tous discrets, c’est-à-dire qu’ils ne disent pas beaucoup de la psychologie des différents personnages. Il y a volontairement, dans le récit, un espace que l’on est invité à remplir (comment est-ce que je réagirais dans cette situation ?). Cela favorise l’implication du lecteur et sa progression dans son identification et ses projets. D’autre part, les récits ne sont jamais achevés. Par exemple, dans le premier récit de la création, le septième jour n’est pas conclu ; la Genèse se termine avec la mort de Joseph qui ne veut pas être enterré en Égypte mais veut que son corps revienne en Terre Sainte sans qu’on sache pourquoi ; le Pentateuque s’achève de l’autre côté du Jourdain ; voir aussi la fin de l’Ancien Testament. C’est pareil dans le Nouveau Testament : voir la fin de l’Apocalypse, les paraboles. La façon dont on achève le récit révèle quelque chose de notre propre projet, de notre identification et de notre espérance.
Ne pas oublier le b.a. ba d’un récit : une situation initiale, une complication, adjuvants/opposants, une sortie de crise et une conclusion, souvent ouverte pour que ça puisse repartir. La plupart des grands récits sont répétés plusieurs fois dans la Bible (création, déluge, exode, …) ; ils comprennent souvent les mêmes éléments mais inversés (par exemple, sortie Égypte et retour de Babylone).
On peut retenir deux principes : le principe de finalité et le principe d’identification.
Saint Augustin, qui a beaucoup travaillé dans la catéchèse, a un principe simple mais très intéressant: le programme, c’est de percer le dessein de Dieu, qui se donne principalement dans sa Parole ; en lisant les récits bibliques, on fait deux opérations, on connait Dieu et on se connait soi-même. Les deux sont liées ; au fur et à mesure que l’on entre en connaissance, en communication et en communion avec Dieu on entre en même temps en connaissance, en communication et en communion avec soi-même. Se connaitre soi-même, c’est une quête fondamentale universelle de l’humanité. En le faisant, nous honorons un projet à la fois divin et humain.
N’en ayons pas peur mais soyons attentifs tout de même à une certaine dose de psychanalyse dans les effets produits par les récits bibliques dans lesquels nous nous introduisons. Il faut bien veiller aux effets induits par la confrontation à tel ou tel personnage, telle ou telle situation, tel ou tel projet. Cela va bien plus profond qu’on ne l’imagine. Voir, par exemple, le récit de Genèse 24.
Enfin, la confrontation au récit biblique nous fait aussi entrer dans le projet d’alliance entre Dieu et nous où Dieu exerce, par sa miséricorde, toute sa puissance de salut, de rédemption et de réconciliation. On découvre ses fragilités et on découvre le projet de la réconciliation.
Quand on veille à tous leurs ingrédients, les récits bibliques sont d’une force incomparable.