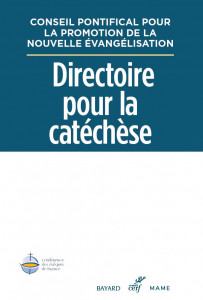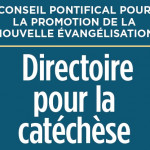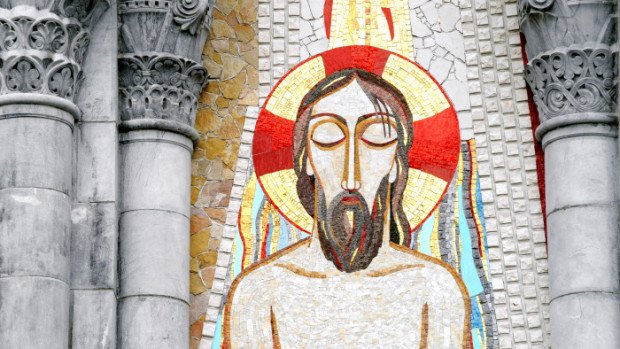Quels contenus de foi dans la pédagogie d’initiation ?
En guise d’introduction à la session d’été 2011 du SNCC, Joseph Herveau a précisé la problématique qui allait animer cette formation : « Quels contenus de foi dans la pédagogie d’initiation ? ».
La question de notre session « Quels contenus de foi dans la pédagogie d’initiation ? » peut avoir de quoi surprendre. En effet, c’est une question surprenante dans sa formulation même, car elle pourrait laisser entendre que la catéchèse ne serait qu’une « enveloppe » dans laquelle il y aurait -ou non- des « contenus de foi », ou en sens inverse, qu’un contenu de foi pourrait exister de façon isolée, comme un « en-soi ».
« Quel contenu de foi dans la catéchèse ? » C’est dans le contexte du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France -qui caractérise la responsabilité catéchétique de l’Église par le choix de la pédagogie d’initiation1-, que se pose pour nous cette question. Elle est fréquente, et les membres du SNCC l’entendent régulièrement dans les sessions qu’ils organisent ou auxquelles ils sont invités à participer.
Il y a quelques mois (du 15 au 18 février dernier) le colloque de l’ISPC y était consacré, avec un arrière fond international. Pour ouvrir cette session d’été du SNCC, je vais m’inspirer de ce que j’avais eu l’occasion d’exprimer à cette occasion.
Pour moi, cette question en pose deux autres :
- Pourquoi nous posons-nous une telle question ?
- Que désigne-t-on par l’expression « contenu de la foi » ?
Pourquoi nous posons-nous une telle question ?
Si nous nous demandons quelle est la place du contenu de la foi en catéchèse, c’est probablement parce que nous pensons ne pas les y trouver, ou pas suffisamment. C’est en tout cas assez souvent dans ce sens qu’elle nous est posée lors de nos sessions ou rencontres.
C’est intéressant parce que même en appréciant la capacité d’adaptation à de nouveaux défis que permet la pédagogie d’initiation, tout se passe comme si une forme d’insatisfaction demeurait, comme si la PI avait « oublié » de prendre en charge une « facette », la facette principale ? En tout cas une facette importante de la catéchèse telle que nous avons pu la connaitre par le passé.
Mais, à ce moment là, n’est-ce pas plutôt là -sans aucun dénigrement du terme- la « doctrine » qui nous manque ? Ne serait-ce pas d’elle dont nous parlons lorsque nous employons l’expression « contenu de la foi » ?
A une époque où l’on parle de « crise de la transmission » sur fond d’un sentiment de « perte d’identité », cela peut être une tentation, au moins inconsciente, qu’il peut valoir la peine d’identifier, si l’on ne veut pas courir le risque de ne transmettre qu’une « culture » ou des « valeurs » chrétiennes alors que les évêques nous invitent à « proposer la foi ». D’autant plus que c’est assez souvent ainsi que s’expriment certaines demandes d’inscription au catéchisme : « je veux que mon fils –ma fille- ait des valeurs, qu’il connaisse l’histoire de Jésus », sans parler du fameux « les jeunes de maintenant n’apprennent plus rien au catéchisme » entendu encore de ci, de là…
On saisit bien ici que ces demandes, conscientes ou inconscientes, proviennent d’un modèle de catéchèse dite « d’entretien » marqué par sa mise en œuvre dans un contexte de « bain ecclésial » qui tend à disparaître aujourd’hui, et où une certaine « fonction enseignante » de la catéchèse était prédominante ; son rôle –que l’on comprend bien- visait à projeter du sens, à développer de façon didactique tout ce qui était alors vécu par une participation réelle et bien ancrée à la vie de l’Eglise.
Or dès la « lettre aux catholiques de France », les évêques nous invitaient –nous nous en souvenons à passer de cette « catéchèse d’entretien » à une « catéchèse de proposition » qui intègre le « tout » de la vie ecclésiale.
Sans dévaloriser ces demandes, ni opposer « culture et valeurs chrétiennes » et « foi chrétienne » l’un à l’autre, ne serait-il pas nécessaire de les articuler ou de les réarticuler ? Est-ce la foi chrétienne qui serait à l’origine de la doctrine et des valeurs chrétiennes ? Serait-ce l’inverse ?
Nous ferons l’hypothèse ici que cette « doctrine », ou ces « articles de catéchisme qui nous manquent tant, participent de la mise en mots de l’expérience croyante, et en sont une expression authentique et légitime, mais qui ne peut jamais se substituer à l’expérience croyante.
Pour le dire d’une autre façon, le kérygme que le livre des Actes met dans la bouche de Pierre : « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 36) ne se réduit pas au sens des mots qui le composent. Il est inséparable d’une expérience bouleversante dont il n’est que l’expression.
Reste qu’il faudra envisager au cours de cette session quelle forme et quelle place peut prendre cette double « mise en mots » de l’expérience croyante. Double parce qu’elle engage l’Eglise, mais aussi chacun de nous.
Car une « catéchèse de proposition » n’a pas à renoncer à une fonction enseignante, mais bien à situer celle-ci à sa juste place.
Un premier temps de notre session nous donnera l’occasion de formuler, chacun pour soi « l’arrière fond » de la question de notre session :
- Pourquoi est-ce que je me pose cette question des contenus de foi dans la PI ? Quelle(s) circonstance(s) ou quelle(s) réflexion(s) me font me la poser ?
Que désigne-t-on par l’expression « contenu de la foi »
Il existe différentes façons de répondre, mais voici ce que l’on trouve dans le TNOC : « la catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, librement, veulent participer à son expérience
et à sa connaissance de la foi ». Je note que l’expression « contenu de foi », n’y figure pas, mais que l’on y trouve une autre formule : « connaissance de la foi ».
Cette citation me semble éclairante parce qu’elle est justement porteuse de la description d’un « processus » en trois temps2 : la catéchèse y est située comme une proposition de la communauté chrétienne à des personnes qui demandent à participer à son expérience et à sa connaissance de la foi.
Or il y a -dans ce processus- comme un lien de causalité que l’on peut aussi bien lire à rebours : « la connaissance de la foi se trouve « dans » la participation à l’expérience de ce que la communauté chrétienne3 propose. » Autrement dit, un « contenu de foi » qui serait isolé de la participation à l’expérience de Dieu que fait la communauté risquerait de ne plus fonctionner comme un contenu de foi -qui est aussi un savoir-, mais comme un savoir seulement. Ce qui le rend actif comme « contenu de foi » est qu’il s’agit d’une proposition de la communauté de foi qui est l’Eglise.
C’est l’un des enjeux du passage d’une catéchèse d’entretien -possible quand un « bain ecclésial » existe- vers une catéchèse de proposition qui, pour proposer la foi, doit proposer l’expérience croyante de l’Eglise précisément comme une expérience, et non d’abord ou seulement comme la présentation et/ou l’explicitation de la doctrine qui en résulte.
Plus encore, nous pouvons lire dans ce « processus » celui-là même par lequel peuvent exister des contenus de foi, à savoir l’expérience croyante de l’Eglise, qui préexiste évidemment à ses affirmations doctrinales : L’expérience pascale dont les premières communautés chrétiennes ont vécu auprès des apôtres a donné les Evangiles et les symboles de foi. C’est dans la liturgie et la prière de l’Eglise que cette foi se reçoit, se découvre, se restitue, comme un Don de grâce et pas d’abord ou pas premièrement comme une explication.
Mais peut-être avons-nous du mal à reconnaître « à la source » nos contenus de foi, lorsqu’ils ne sont pas présentés sous la forme d’un article de catéchisme ou d’une explication sur ce que nous croyons.
Voilà pourquoi nous nous proposons donc, au cours de cette session, de redécouvrir le processus par lequel la foi se met en mots : Comment, depuis l’âge apostolique, l’Eglise s’y prend-elle pour dire avec
des mots son expérience de la foi ?
Notre intervenant le P. Sesboüé nous aidera demain à entrer plus avant dans cette « mise en mots de l’expérience croyante de l’Eglise », puis dans le « statut des formulations de la foi ». De ce point de vue, et en préparation de la seconde journée, nous nous replongerons dès cet après-midi dans la liturgie de l’Eglise, comme « haut lieu » de l’expérience croyante, à l’invitation des évêques qui proposaient il n’y a pas si longtemps à l’Eglise de France d’« aller au cœur de la foi » , au cœur du mystère pascal et son actualisation : la liturgie pascale.
Enfin, il nous restera mercredi matin à croiser nos différentes « récoltes » avec ce que nous percevons de la pédagogie d’Initiation voulue par les évêques de France.
S’intéresser à la pédagogie d’Initiation comme caractéristique de la nature de l’acte catéchétique, c’est entendre le choix d’une perspective résolument catéchumenale au sens large, c’est-à-dire, située
dans le sens d’un devenir chrétien permanent concernant toute l’Eglise pour elle-même, chaque membre de l’Eglise pour lui-même, dans toutes les dimensions de son être, à toutes les étapes de sa
vie.
Le rituel de l’initiation chrétienne4 des adultes met en œuvre un premier dialogue au tout début de l’initiation : « Que demandez-vous à l’Eglise ? » demande l’évêque à celui qui veut devenir chrétien.
« La foi ! », répond ce dernier. Le rituel n’a pas prévu qu’a cette réponse succède un exposé de la foi, – cela viendra en son temps- mais bien une insertion dans la communauté croyante qu’est l’Eglise.
- Que nous inspire cette insertion symbolique dans la communauté ecclésiale ?
- Quelle place accordons-nous au travail du temps dans nos propositions catéchétiques ?
Le « que demandez-vous à l’Eglise » est à lui seul emblématique de la part que la PI offre aux questions existentielles des personnes, à leur liberté, mais aussi au désir de Dieu, au travail de
l’Esprit…
- Comment situons-nous nos propositions catéchétiques aujourd’hui, pour qu’elles ne fonctionnent pas comme une réponse à une question qui ne se pose pas, ou pas encore, ou pas en ces termes,
mais bien comme un accueil de ce que l’Esprit a déjà fait au cœur des personnes « avant même que ne commence le travail catéchétique » ? (TNOC 3.1, p. 47)
Enfin, au moment de son baptême, lors de la nuit pascale : suivra un autre dialogue : « -Croyez-vous en Dieu le Père ? -Nous croyons » « -En Jésus son Fils ? -Nous croyons !» « En l’Esprit-Saint ? –Nous
croyons ! ». La foi ne se trouve ni dans la seule triple question de l’évêque, ni dans la seule triple réponse de l’assemblée, mais dans la conjonction de l’un et de l’autre. La foi est un sunbolein. Elle
est « symbole » au sens fort. Elle fait dialoguer et fides qua creditur (acte de foi personnel) et fides quae creditur (foi objective révélée). C’est là, dans ce dialogue, que la foi est « crue ».
- Quelle place dans nos propositions catéchétique pour un dialogue entre la foi de l’Eglise et celle qui se construit en chacun de nous ? Dans quel sens ? Dans quel ordre ? De quelle façon ?
Il nous faudra alors questionner nos expériences, nos pratiques catéchétiques en ce sens pour mieux découvrir le contenu de la foi qui y est actif. Mais aussi, y interroger notre rapport à un dessaisissement- distinct d’une déresponsabilisation- de cette conversion que qui ne nous appartient pas, mais pour laquelle nous avons a « réunir les conditions qui lui seront favorables ».
- Comment situons-nous le rôle qui est le notre, caractérisé par l’expression « ainé dans la foi », lorsque nous mettons en œuvre des propositions d’itinéraires selon une pédagogie d’initiation ?
Conclusion
Vaste programme, dont l’itinéraire est balisé à grands traits…
Je terminerai par quelques citations -que vous connaissez par cœur- et qui devraient nous laisser croire en une possible issue heureuse de notre session. J’ai bien conscience qu’il ne suffit pas ici de marteler
ce texte national que nous commençons fort heureusement à bien connaitre. Mais l’enjeu de cette session- est de faire un pas de plus dans en vue d’une compréhension plus profonde de ce qu’il vise, en
vue également –parce que tout est là- d’évaluer de façon critique et constructive la façon dont nous le mettons en œuvre, et d’entendre à nouveau, ensemble, les diverses interpellations qu’il nous lance
pour véritablement proposer la foi dans l’époque qui est la notre.
« Le but définitif de la catéchèse, c’est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ » (Jean-Paul II, Catechesi Tradendae 5 TNOC p 23)
« La catéchèse n’est autre que le processus de transmission de l’Evangile tel que la communauté chrétienne l’a reçu, le comprend, le célèbre, le vit et le communique de diverses manières » (DGC §
5 TNOC p 53)
(le TNOC) « fait droit à la pédagogie originale de la foi, ouvrant des voies à la catéchèse permettant d’harmoniser, sans jamais les séparer, tant l’accueil du don de Dieu dans l’expérience
ecclésiale (fides qua) que l’enseignement du contenu objectif du message chrétien (fides quae) » (Congrégation pour le clergé, recognitio du TNOC.)
« Pour introduire dans l’expérience chrétienne, la catéchèse a besoin de s’adresser à la personne globale, à la fois au cœur et à l’intelligence, à la volonté et à la mémoire. (…) Les moments et les
modalités de ces nécessaires apports de connaissances doivent s’intégrer dans le processus général de l’initiation. (…) L’initiation ne s’oppose donc pas à la fonction d’enseignement. Elle a
une dimension didactique. En introduisant dans l’expérience que porte l’Eglise, elle honore le contenu objectif de la foi » (TNOC p 41)
—
1. « (?) la catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, librement, veulent participer à son expérience et à sa connaissance de la foi. Pour caractériser aujourd’hui la responsabilité proprement catéchétique de l’Église, nous faisons le choix de la pédagogie d?Initiation » TNOC. p. 27, 1.3. « La vocation missionnaire de l’Église appelle le choix d’une pédagogie d?Initiation. »
2. (1 proposer- 2 participer/expérimenter- 3 connaitre)
3. « La communauté chrétienne est en elle-même une catéchèse vivante. En vertu de ce qu’elle est, elle annonce, célèbre, agit et demeure toujours le lieu vital, indispensable et premier de la catéchèse. » Directoire Général pour la Catéchèse § 141.
4 RICA § 80 RR75
Contenus de la foi et pédagogie d’initiation (2011)
Une session d'été du SNCC pour interroger la compréhension du Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France : contenus de la foi et pédagogie d'initiation. Du lundi 4 au mercredi 6 juillet 2011 s'est tenue à la Maison de la Conférence des évêques de France la session de formation « Quels contenus de foi dans la pédagogie d'initiation ? ».